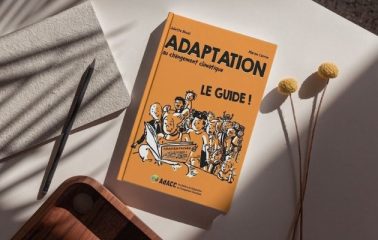La première responsabilité climatique des marques est de démontrer la matérialité et la réalité de leur transformation – au cœur de leur métier, de leur offre et de leur modèle économique, voire de leur mission et de leur positionnement, sans quoi elles ne sauraient être convaincantes.
Levier #1 Mener la transition proactive de ses produits vers le bas carbone, via l’innovation et la rénovation
Le premier pas, qui est aussi le début d’un long chemin, est évidemment la transformation des produits ou services proposés par la marque – pas juste pour en limiter les impacts négatifs mais pour aller très concrètement rénover les offres, aligner modèle économique et transition écologique, changer la façon-même dont la marque gagne de l’argent et les raisons pour lesquels ses clients la payent.
L’enjeu est de taille : il s’agit d’aller au-delà de l’argument généralement avancé par les détracteurs de la consommation responsable, qui pointent du doigt la faible part de marché des offres mieux-disantes pour nous expliquer que les consommateurs « disent vouloir une chose et font l’inverse », en préférant se rabattre sur des produits moins vertueux mais aussi moins chers au moment de l’achat effectif. Pour- tant, dans tous les pays, plus de 80% des consommateurs disent vouloir prendre en compte les engagements sociaux et environnementaux dans le choix des marques et produits qu’ils consomment au quotidien. Et si, plutôt que de mettre cette contradiction apparente sur le compte d’une supposée « schizophrénie » du consommateur, on avait tout simplement mal posé le problème depuis le début ? En pariant sur le fait que c’était la demande qui avait seule la capacité à faire évoluer les choses ? Comment, de toute façon, identifier avec certitude cette demande des consommateurs tant qu’elle reste latente, en attente justement de l’offre capable de la traduire en actes d’achat ? Peut-on encore, vraiment, concevoir des produits en pensant à une ménagère type « de moins de 50 ans » incapable d’appréhender des choses complexes et faisant toute confiance aux marques, une supposée « Madame Michu » inventée dans les années 50 et qui aujourd’hui à l’évidence n’existe plus… tant la ménagère « moyenne » est désormais parfaitement branchée sur les réseaux sociaux et bien informée par Cash Investigation ? Et si on cessait d’attendre un hypothétique changement de la demande, pour considérer qu’il s’est déjà sans doute produit à notre insu – comme en témoignent le succès de la consommation collaborative ou celui des circuits courts ? Il est temps de changer de perspective et d’activer plutôt le levier du marketing de l’offre, comme nous invite à le faire cette citation d’Henry Ford qu’aimait à citer Steve Jobs « Si j’avais écouté mes clients, je leur aurais donné un cheval plus rapide et pas une voiture ».
Et parce qu’il est sans doute inévitable que cette trajectoire commence sans en être une vraiment définie, avec un produit « vert » ou une gamme responsable isolés, posons clairement les choses : pour être convaincante, cette transformation ou rénovation de l’offre (dans le cas d’une marque qui n’est pas sustainabi- lity-native) doit s’inscrire dans une perspec- tive claire de choice editing, qui généralise progressivement les options (climatiquement) responsables et renonce à celles qui ne le sont pas (voir section suivante). À noter : certains (comme le climatologue François Gemenne) vont jusqu’à dire qu’il est important que les produits climatiquement responsables ne soient pas juste la « version plus verte » d’un best-seller conventionnel, mais qu’ils aient au contraire leur identité et leur design propres, de manière à faire jouer en leur faveur les normes sociales qui « signalent » le consommateur responsable – comme c’est le cas pour le conducteur de la Toyota Prius qui n’existe qu’en version hybride ou électrique.
Une approche pragmatique et efficace dont s’inspirer est celle adoptée par les deux fondateurs de Veja, la marque devenue iconique de baskets bio-équitables, mais aussi désormais vegan, recyclées, etc. Leur démarche, qui vise à réinventer ce produit emblématique de leur génération, part, non pas de grandes déclarations, mais de la réalité du terrain – comme l’annonce ce slogan dans la boutique de New-York : sustainability is an empty word, we choose reality (le développement durable est un mot-valise, nous préférons la réalité). L’idée derrière Veja, depuis l’origine, est en effet de « faire des baskets plus écologiques et plus équilibrées – en les décomposant puis en reconstruisant chaque étape de la chaîne de valeur pour optimiser l’impact sur l’environnement, la justice économique, le développement social »16. Pour cela, Veja source notamment les matières premières en direct – et ses fondateurs concèdent que « le fait d’aller voir les producteurs permet de comprendre toute la chaîne, de comprendre leur monde et les enjeux. Cela vous rend aussi plus résilient, en cas de mauvaise récolte par exemple on anticipe et on trouve les solutions en amont ». Concrètement, ils ont depuis toujours fait le choix du coton labellisé bio et équitable dans le nordeste brésilien et utilisent 40 à 60% de caoutchouc sauvage et équitable sourcé directement dans la forêt pour fabriquer les semelles de leurs modèles – alors que l’approche dominante sur le marché reste dans le caoutchouc synthétique (à base de pétrole), le polyuréthane ou le plastique. Avec le temps, la marque a élargi sa démarche et le cuir représentant plus des 3/4 de l’empreinte carbone tous scopes confondus (un modèle en cuir émet 4 fois plus de CO2 qu’un modèle en coton biologique), elle a lancé une gamme de baskets vegan qui représente désormais 30% de sa collection : ces baskets sont fabriquées à partir de C.W.L. (Cotton Worked as Leather), une alternative au cuir à 63% biosourcée car en toile de coton biologique recouverte d’un enduit à base d’huile de maïs. Toute la démarche est détaillée, avec chiffres à l’appui sur l’im- pact carbone (jusqu’au scope 3) ou la performance globale de l’entreprise (le détail de son questionnaire B Corp est accessible en ligne) sur le site de la marque… où une page « Limites du projet » détaille aussi de manière transparente tout ce qui, dans les produits ou les pratiques, n’est pas encore à la hauteur des ambitions de Veja.
De manière un peu similaire, la marque Picture Organic Clothing, créée en 2008 à Clermont-Ferrand et qui s’est dès l’origine donné pour mission de lutter contre le changement climatique et d’inscrire l’engagement environnemental dans chaque aspect de son activité, s’efforce d’avoir des produits exemplaires depuis toujours. Deux de ses trois piliers fondateurs portent d’ailleurs sur les produits : un design rupturiste, et un engagement sur la fabrication (matières biosourcées, matières recyclées, bio, intégration du sujet de l’impact en fin de vie) … en plus d’une nouvelle vision plus inclusive de l’outdoor, pour sortir des cli- vages ski/skate/snowboard/surf. Soucieux d’aller au-delà d’une simple « gamme verte », Picture a déployé sa démarche sur l’ensemble de sa collection – qui est composée au minimum avec 50% de matières premières biologiques, recy- clées ou biosourcées… Pour parvenir à de tels résultats, Picture a déployé une dé- marche partenariale et de co-innovation, gage d’efficacité et de rapidité. C’est le cas pour les matières, par exemple autour du bio-sourcing en partenariat avec Lenzing (Tencel, Ecovero), et autour de la production de matières recyclées à partir de bouteilles, en partenariat avec Flying Tex (Taiwan) et Repreve. Picture s’allie également avec d’autres acteurs de sa catégorie, en l’occurrence Decathlon, pour faire changer certains de leurs fournisseurs communs (ce qui permet de réduire les émissions duscope 3 amont) – par exemple un filateur turc de coton, qui utilise désormais l’énergie solaire à hauteur de 40% de ses besoins, alors même que l’essentiel de l’énergie nationale est produit à partir de la combustion de charbon. C’est aussi une démarche communautaire qui a aidé Picture à faire de grands progrès sur sa supply chain, et notamment l’utilisation des polybags plastiques emballant les produits. Picture a en effet rencontré PrAna, une marque américaine de climbing et de yoga, labellisée B Corp comme Picture, qui a réussi à supprimer les polybags. Dans une logique de coopération, cette entreprise a partagé sa « bible logistique » et a permis à Picture d’avancer bien plus rapidement sur cette problématique des déchets plastiques. À ce jour, Picture a mis en place la suppression des polybags sur les produits où ils ne sont pas nécessaires (combinaisons de surf, gourdes), livre ses produits sombres dans des rollpacks (les produits sont roulés sur eux-mêmes et noués dans un bandeau en carton), et plie les produits clairs en quatre, diminuant par quatre la quantité de plastique nécessaire pour l’emballage. Les commandes en ligne sont également expédiées dans des emballages réutilisables, RePack, qui sont préaffranchis et prépayés pour être renvoyés et servent jusqu’à 50 fois.
Dans le même esprit collaboratif et proactif, le leader des dalles de moquette Interface (voir interview ci-contre), engagé dès 1994 sur un programme Zero Footprint à horizon 2020, a transformé au fil du temps son offre d’une manière particulièrement inspirante – puisqu’il s’agissait à la base d’une entreprise B2B classique avec des produits reposant fortement sur l’utilisation de pétrole (les dalles de moquette sont faites avec des fibres synthétiques et une sous-couche bitumineuse). Aujourd’hui 52% des matériaux de ses revêtements de sol sont recyclés ou biosourcés, et 99% de ses produits disposent d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire accessible en ligne 17 – une pratique soumise à vérification externe et dont la marque a été pionnière sur son marché dès 2009. Interface a également modifié la conception de ses produits pour les rendre réemployables et recyclables – et la marque a lancé le programme ReEntry, à nouveau avec des partenaires locaux, pour récupérer les dalles de moquette usagées de ses clients et leur donner une seconde vie, à travers des opérations de réemploi. Enfin, Interface a lancé plu- sieurs gammes-phares de sa démarche, en plaçant le climat parmi ses priorités historiques : ainsi la marque a proposé dès 2003 des revêtements de sol « neutres en carbone » en compensant le cycle de vie complet des émissions de GES de ses dalles de moquette, sa démarche étant soumis à vérification externe, et Interface n’étant pas soupçonnable de se limiter à la compensation puisque l’entreprise ré- duisait en parallèle son empreinte car- bone de 97% depuis 1996, passant aussi à 79% d’énergie renouvelable sur ses sites ; depuis 2014, Interface a développé la gamme NetWorks avec une ONG environnementale et l’un de ses fournisseurs, Aquafil – l’objectif est de proposer aux communautés de pêcheurs pauvres des Philippines ou au Cameroun, de ré-cupérer des filets de pêche usagés, d’ordinaire abandonnés sur les plages ou au fond des océans avec un impact environnemental désastreux ; Interface revend cette matière à son fournisseur et obtient ainsi une source de nylon entièrement recyclé pour fabriquer ces dalles de moquette parfaitement circulaires… ; enfin sur cette lancée, et boostée par son nouveau programme Climate Take-Back (qui ambitionne de devenir une entreprise carbone-négative d’ici à 2040), la marque a développé les sous-couches CQuest et la gamme de dalles de moquettes Embodied Beauty, avec de nouveaux matériaux biosourcés et plus d’éléments recyclés, de manière à stocker plus de carbone que leur fabrication n’en libère, et à présenter un bilan carbone net négatif.
Levier #2 Recourir à des labels… ou développer des outils internes d’évaluation/ communication de l’impact climatique et global des produits
Pour concevoir des produits mieux-disants, ou rénover des produits existants, tout en s’assurant de pouvoir communiquer ces efforts à ses clients, l’approche la plus évidente est le recours à des certifications externes – reposant sur des cahiers des charges robustes définis par des tiers et avec une performance sou- mise à vérification indépendante. On a vu, notamment, comment Veja a commencé par combiner les certifications bio et équitables pour établir la robus- tesse de son offre. Ces certifications, faut-il le rappeler, sont toujours plus crédibles qu’un « auto-label » défini par la marque elle-même pour ses produits, qui ne les rend par définition pas compa- rables à ceux de ses concurrents et qui ne permet pas, dans la communication aux clients, de s’appuyer sur une notoriété pré-existante du label. Sans compter les risques que l’entreprise soit taxée d’avoir recours à des critères « maison » pour s’affranchir des exigences trop strictes des éventuelles certifications existantes…
Mais sur les questions climatiques, en l’absence de label international et transsectoriel sur la dimension bas carbone, et compte-tenu du flou qui entoure historiquement les quelques-uns qui ciblent la « neutralité carbone » (voir en- cadrés), le choix est souvent limité pour les marques… Par ailleurs, l’interdépendance entre les questions climatiques et d’autres enjeux environnementaux (comme l’eau, la biodiversité, la circularité…) étant désormais bien connue, se cantonner à une action de réduction des émissions de GES, malgré l’urgence de l’enjeu, n’est pas forcément une réponse satisfaisante à long-terme pour la marque.
C’est pourquoi, par exemple, Patagonia et une autre marque d’hygiène-beauté faisant partie des meilleures B Corp au monde, Dr Bronner’s, se sont engagées depuis 2017, au-delà du bio sur lequel elles étaient engagées de longue date, à soutenir l’émergence d’une nouvelle certification holistique d’agriculture biologique régénératrice, Regenerative Organic Certified (ROC) – partant du constat que l’agriculture conventionnelle est responsable de près de 25% des émissions qui génèrent la crise climatique et enrichissant notamment les strictes exigences de la bio : elles y ont ajouté en particulier les pratiques de l’agriculture de conservation des sols qui piègent le carbone dans le sol 18, le bien-être animal et l’équité en- vers les producteurs ou travailleurs agricoles.
Depuis, ce terme d’agriculture régénératrice s’est répandu dans les groupes agro-alimentaires et les marques de mode qui laissent de côté le bio (jugé trop cher au regard des volumes achetés) et la certification ROC pour se concentrer sur les pratiques climatiquement vertueuses de conservation des sols (refus du labour, couverture du sol, rotation des cultures). Le problème est qu’à l’inverse du bio qui était la base du concept et dont les pratiques sont strictement encadrées, l’agriculture régénératrice relève pour l’instant de stratégies discrétionnaires, sans définition légale ni contrôle. Le bénéfice de l’agriculture régénératrice reste donc difficile à communiquer simplement aux consommateurs : les labels apparus récemment, comme Regenagri, sont peu connus et peu utilisés (les cafés Illy viennent d’obtenir le label pour une gamme brésilienne), et ils n’intègrent pas le bio dans leurs critères. Dommage car comme l’a montré un rapport de la Cour des Comptes 19, l’agriculture biologique est meilleure pour le climat que l’agriculture conventionnelle mais aussi que l’agriculture de conservation – à l’échelle de la parcelle du fait des faibles intrants azotés par rapport à ces deux agricultures, plus fortement émettrices de GES, mais aussi, à l’échelle des exploitations, compte-tenu de leur souci d’autonomie, de leur recherche d’une complémentarité renforcée entre production animale et végétale, de leur mode de fertilisation axé autour d’apports de matière organique et de l’introduction de légumineuses dans les rotations, et enfin de leur recours fréquent aux circuits courts. Même s’il est vrai aussi que les moindres rendements des exploitations bio conduisent cependant à relativiser le bénéfice.
De ce côté-ci de l’Atlantique et au-delà de l’agriculture, l’Ecolabel européen est un autre label holistique et robuste, pro- mu par les Pouvoirs Publics depuis 30 ans, qui permet de reconnaître les produits ayant un moindre impact sur l’environnement et le climat. Aujourd’hui affichés sur près de 90 000 produits en Europe, il présente aussi l’intérêt d’être connu des consommateurs (7 Français sur 10 déclarent connaître l’Ecolabel Européen et 1 Français sur 5 en avait déjà acheté, lors des 25 ans du label), d’autant plus qu’on le retrouve sur une trentaine de catégories de produits – des produits de bricolage à ceux de jar- dinage, en passant par l’hygiène, le pa- pier, les matelas, les hébergements touristiques, les détergents et les ser- vices de nettoyage, la mode et les équi- pements électroniques. Un des points forts de l’Ecolabel européen est qu’il est multi-critères (il prend en considération les questions climatiques dans une ap- proche globale qui n’ignore pas les autres dimensions complémentaires : eau, biodiversité, circularité, etc.) et qu’il est pensé dans l’esprit de l’écoconcep- tion, prenant en compte l’intégralité du cycle de vie du produit, depuis le prélè- vement des matières premières jusqu’au moment où le produit devient un déchet et est jeté. Ajoutons que ces critères en- vironnementaux sont révisés régulière- ment (afin de garantir la qualité du label et de suivre les dernières innovations) afin que seuls 10 à 20% des produits sur le marché considéré puissent obtenir l’Ecolabel…
Pour les produits complexes, les marques multi-sectorielles ou les catégories de produits sur lesquels il n’existe pas encore de label indépendant intégrant les questions climatiques, une approche intéressante (et indispensable) pour faire évoluer son offre est la mise en place, à l’initiative de l’entreprise et idéalement avec un comité de parties prenantes externes, d’un système de scoring multi-critères des produits permettant d’orienter l’innovation ou la rénovation des produits existants, mais aussi de piloter l’évolution de la part du chiffre d’affaires « responsable » ou encore de décider de concentrer les moyens marketing sur les produits mieux-disants (ce qui peut être un objectif, et un gage de crédibilité de sa démarche, pour la marque).
Ainsi, sur un marché où il n’existait pas de certification externe, AXA France a-t-il mis en place, depuis 2016, le « label » interne Assurance Citoyenne, développé de manière collaborative avec un panel de parties prenantes (dont une association de consommateurs et une ONG environnementale) 20 puis vérifié par un tiers auditeur, qui s’est progressivement déployé sur 100% des nouvelles offres et 80% des offres totales. Les critères du label obligent les offres à inclure un service de prévention et à respecter un cahier des charges précis autour de quatre en- gagements (confiance et transparence notamment sur les garanties et les exclusions, environnement, prévention, soutien à l’économie responsable), adapté à la catégorie de produits considérée (assurance ou épargne). Le contenu du label est évolutif et soutenu par un site de crowdsourcing où les clients peuvent poster leurs idées pour une assurance encore plus citoyenne. Les résultats sont au rendez-vous : d’après les études internes 21, les clients et prospects qui connaissent le label et son contenu ont une intention d’achat 5 fois supérieure à ceux qui ne le connaissent pas, et cette démarche a conduit l’entreprise à multiplier par 5 également ses investissements dans les infrastructures vertes. Une telle approche, on l’a vu, a des limites évidentes, même avec l’audit d’un tiers indépendant – car un label doit en théorie rassurer les clients, certes, mais aussi leur permettre de comparer entre
elles des offres concurrentes (ce qui n’est pas possible avec un système de scoring interne) : pour pallier à ces problèmes, AXA a dès le départ annoncé la mise en open-source de la méthodologie, dont les référentiels sont accessibles en ligne pour ses clients… et ses concurrents.
Enfin, à l’image d’Interface avec ses fiches de déclaration environnementales, les marques s’engagent de plus en plus souvent, à partir de leur système de scoring interne des produits, dans un reporting « produits » venant compléter le reporting corporate. Patagonia a lancé il y a dix ans déjà le site « Chronique de notre empreinte » (Footprint Chronicles) qui détaillait, pour chacun de ses produits, l’origine géographique et la performance environnementale ou so- ciale associée de chaque composant… le tout étant résumé par une carte qui montre le « parcours » des produits, et une fiche de synthèse qui explique « ce qui marche », « ce qui ne marche pas » et un commentaire de la marque sur ses efforts pour améliorer ce qui ne marche pas. De la même façon, Apple rend disponible sur son site depuis des années un Product Environmental Report22 organisé en 4 ou 5 pages autour de trois enjeux-clefs (changement climatique, consommation de ressources et santé environnementale) pour chaque produit-phare de sa gamme. Sans surprise, on retrouve aussi des enseignes de distribution sur ce créneau, pour les marques propres dont elles contrôlent le cahier des charges : ainsi le distributeur suisse Migros, connu pour son en- gagement historique autant que pour la qualité et la quantité de ses marques propres (222 au total en 2020, toutes ca- tégories confondues, représentant 80% de son chiffre d’affaires), a ainsi lancé mi- 2022 un label M-Check qui évalue (et note de 1 à 5, avec des partenaires ex- ternes) les produits des marques Migros en matière de compatibilité climatique, de bien-être animal, d’emballages écologiques, de sources responsables pour les poissons et de l’économie circulaire. Environ 50% des produits Migros ont reçu une étoile dans le domaine du climat… et seulement 5% des produits ont obtenu 5 étoiles – de quoi s’autostimuler pour l’évolution de l’assortiment !
Levier #3 Oser la transformation radicale de son offre globale, quitte à abandonner une partie de son activité (choice editing)
De manière croissante, pour une marque, développer une gamme vertueuse « isolée » ne suffit plus – car les clients auront toujours des raisons de ne pas la choisir (soit que le prix en soit plus élevé, soit qu’elle soit peu connue car non prioritaire en communication, …) : l’effort doit guider l’ensemble des gammes, et la marque viser la transformation de 100% de son offre – on sait que le choix par défaut est le meilleur nudge et la meilleure incitation à consommer responsable (voir page 59). Il est d’ailleurs révélateur à cet égard de noter que le référentiel du label B Corp, par exemple, pose systématiquement deux questions pour évaluer le sérieux de la transition dans l’offre : la première consiste à savoir sur quelles certifications externes et indé- pendantes (des matières premières ou des produits) s’appuie la démarche ; et la seconde consiste à savoir quelle part des achats et/ou du chiffre d’affaires est concernée par ce dont on parle (produits contenant une proportion significative de matières premières responsables – la proportion faisant l’objet d’une autre question, produits avec un label ex- terne, produits avec une caractéristique objective – ex. 100 % recyclé, de seconde main, fonctionnant avec des énergies renouvelables, etc.).
C’est dans cet esprit que Volvo est devenu fin 2019 la première marque automobile mondiale engagée à ne plus commercialiser que des véhicules électriques ou hybrides – après avoir été rachetée par le groupe automobile chinois Geely. De même, l’enseigne française et familiale de jardinerie Botanic, qui compte une soixantaine de magasins, a décidé en 2008 de s’éloigner de la vente de pro- duits phytosanitaires de synthèse, lesquels ont dans un premier temps été mis sous clef et non plus proposés en libre-service, pour faire en sorte que les clients qui souhaitaient y avoir accès soient contraints de passer par les vendeurs, qui avaient ainsi l’opportunité de présenter et de proposer les alternatives existantes. Puis les produits ont été définitivement retirés des rayons – un choix qui lui a fait perdre 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008, année de son virage stratégique, et ce malgré les efforts de l’enseigne pour compenser en investissant dans d’autres rayons, comme l’alimentation bio. Un choix courageux dans un contexte où la part des produits phytosanitaires, terreaux et amendements représentait encore 10% du chiffre d’affaires moyen d’une jardinerie en 2012. Toujours sur ce thème des renoncements, la marque d’hygiène Mustela a annoncé qu’elle arrêterait les lingettes pour bébé en 2027, faisant une croix sur 20% de son chiffre d’affaires. Depuis 2015, Mustela a travaillé pour les rendre compostables mais les lingettes restent un produit à usage unique, non durable et dont la loi AGEC prévoit l’interdiction en 2040. « Pour nous, c’est trop tard », explique Sophie Robert-Velut, la directrice générale des Laboratoires Expanscience (voir page 48).
Autre exemple : l’enseigne suédoise Max Burgers, qui fut la première au monde à afficher les émissions de CO2 de ses produits à côté des calories, s’est engagée depuis 2018 sur une réduction radicale de ses émissions (lancement de burgers végétariens, approvisionnement en énergie 100 % renouvelable depuis 2008, achat d’ingrédients locaux, etc.) avec, compte-tenu de l’impact climatique de la viande rouge (les animaux et l’agriculture liée à leur alimentation à base de soja sont à l’origine de 15% des émissions de GES), une volonté notable de réduire proactivement les ventes de burgers à base de viande rouge pour que ceux-ci ne représentent plus que la moitié de ses ventes fin 2022. Cette évolution de son offre et de son marketing lui a permis de réduire ses émissions de 30% en 7 ans, pour un coût estimé à 0,4% du chiffre d’affaires, que l’enseigne espérait compenser en attirant ainsi 1% de clients en plus.
Enfin, tout en faisant de son engagement climatique une source de préférence chez ses clients, New Belgium affiche une volonté marquée d’entraîner son secteur avec elle : la marque a ainsi partagé avec ses concurrents brasseurs artisanaux son plan d’action détaillé pour réduire ses émissions et parvenir à la « neutralité carbone », et participe à plusieurs initiatives de lobbying positif pour inciter les plus gros acteurs privés à mettre en place un plan de « neutralité carbone »…
Comme l’illustrent les cas de Mustela, Botanic, Max Burgers ou New Belgium, cette démarche nécessite de faire des choix courageux, parfois à contre-courant. Car le rôle des marques leaders est de proposer une offre qui anticipe et guide la demande, et non l’inverse, quitte à parfois se séparer de certaines activités. Il est significatif à cet égard, par exemple, que Nestlé ait annoncé en 2019 la cession de la majeure partie des activités de sa marque Herta à Casa Tarradellas, une entreprise espagnole – en décidant néanmoins de conserver le segment des produits végétariens de Herta, considérant que l’alimentation végétale offrait de meilleures perspectives que la viande, auprès des consommateurs mais aussi pour des raisons climatiques. De la même façon, l’enseigne de mobilier CAMIF s’est recentrée, après sa reprise par Emery Jacquillat et son entreprise Matelsom, sur la vente en ligne de mobilier made in France – un choix à contre-courant de son marché dominé par le grand import asiatique. Douze ans plus tard, la CAMIF a renoué avec le succès (ce qu’a confirmé la crise du Covid, puisque la marque a connu une croissance de 44 % en 2020) et elle est passée de 40 % d’offre made in France dans son chiffre d’affaires en 2009 à 78 % aujourd’hui, ce qui représente une centaine de fournisseurs parmi lesquels des marques connues comme Fermob ou Tolix mais aussi beaucoup de petites entreprises – par exemple son premier fournisseur de lits est un ESAT situé à Pau, qui fabrique des lits en pin et travaille à l’insertion des travailleurs handicapés… En juin 2021 la marque a décidé d’aller encore plus loin en arrêtant tous les produits de « grand import », en provenance notamment d’Asie, qui représentaient encore 5 % de ses ventes – ce qui lui permet de revendiquer le fait que 100 % de nos produits sont désormais fabriqués en Europe ! Cela lui donne une empreinte économique et sociale plus forte (chaque emploi créé à Niort génère 14 emplois supplémentaires créés ou maintenus en France) et une empreinte environnementale plus faible, avec moins d’importations : un canapé fabriqué en France a une empreinte carbone neuf fois moins importante qu’un canapé fabriqué en Chine, en raison aussi de l’électricité d’origine nucléaire en France plutôt que de charbon en Chine ! Pour réduire encore son empreinte, CAMIF travaille aussi d’autres dimensions comme le fait d’utiliser plus de matériaux recyclés, de penser la fin de vie de ses produits, ou le lancement de CAMIF Edition, une collection de produits exclusifs co-créés avec des experts de de l’économie circulaire…
Aller à l’encontre des choix de son marché, en l’occurrence sur le rythme de renouvellement des collections, c’est aussi le pari courageux fait par Loom, qui affiche clairement dans son « Manifeste pour une mode plus calme » sa conviction que la clef de l’action climatique dans la mode n’est pas tant l’éco-conception que le fait de produire (et de vendre) moins, des produits de meilleure qualité et qui durent plus longtemps. Du coup Loom prévient ses clients : « n’attendez pas de nous qu’on sorte une nouvelle collection quatre fois par an », invitant aussi ses clients à « ralentir » et à acheter « moins mais mieux ». Sur un marché où l’on achète deux fois plus de vêtements qu’il y a vingt ans en les portant deux fois moins longtemps, ce changement de modèle est à la fois courageux et vertueux.
Le rôle des marques leaders est de proposer une offre qui anticipe et guide la demande, et non l’inverse, quitte à parfois se séparer de certaines activités.
Comme Max Burgers, New Belgium Brewing Company (qui est la 4e plus grosse brasserie américaine, et la 1ère pour les bières artisanales, trente ans après sa création), a commencé par une initiative marquante avant de s’engager à transformer 100% de ses produits. Ambitionnant de « protéger la seule planète où l’on sert de la bière », l’entreprise est reconnue pour sa trajectoire sociale et écologique ambitieuse (elle est certifiée B Corp), qui doit beaucoup aux idées de ses salariés, tous actionnaires de l’entreprise : qu’il s’agisse de proposer une nouvelle manière d’empaqueter les bières avec moins de carton ou d’investir dans l’éolien dès 1998, les salariés répondent oui à l’unanimité. Depuis, New Belgium a également investi dans la production d’énergie dans ses brasseries (énergie solaire et de biogaz issu du processus de traitement de l’eau, dans un contexte où 99,8% des déchets sont déjà réutilisés, recyclés, compos- tés, …). Convaincue qu’il faut investir dans des solutions pour sauver le climat, mais aussi pour pouvoir continuer à produire de la bière (New Belgium explique clairement que la crise climatique menace son ingrédient principal, l’eau, mais aussi les récoltes de houblon et autres matières premières agricoles), l’entreprise a fait de ses marques et de ses produits la vitrine de ses engagements : elle a ainsi fait en 2020 de sa marque-phare Fat Tire (16e bière la plus vendue aux Etats-Unis) la première bière américaine certifiée « neutre en carbone » et dans la foulée, elle s’est engagée à généraliser la démarche de « neutralité carbone » à l’ensemble de ses marques et produits à horizon 2030 – ce qui l’engage notamment à accélérer ses efforts de passage aux énergies renouvelables. Elle a aussi lancé pour la journée de la Terre en 2021 une bière au goût intentionnellement amer car fabriquée exclusivement avec les ingrédients qui seraient disponibles dans un monde au climat ravagé (eau contaminée parlafumée, céréales résistantes à la sécheresse…), la Torched Earth Ale, afin de sensibiliser ses clients au fait que l’urgence climatique menace également le goût de leur bois- son favorite, en les incitant ensuite à l’action climatique. Et New Belgium donne depuis toujours à des ONG (travaillant sur le vélo et la mobilité douce, le climat, la préservation des ressources en eau, l’agriculture durable, etc.) un dollar par fût de 150 litres vendu, ce qui représente près de 20 millions de dollars donnés depuis l’origine.
Un produit-phare de la transformation de l’offre chez CAMIF : le matelas Timothée, lancé en 2021, premier matelas du marché à être entièrement fabriqué en France à partir de vieux matelas recyclés, ce qui représente une économie de 45% sur les émissions de CO2 par rapport à un matelas conventionnel fabriqué en Chine.
Levier #4 Intégrer à sa stratégie la fin de vie des produits, par la réparation et la circularité
Un autre levier important pour alléger l’empreinte climatique de son offre, dans un monde qui commence donc à se lasser de la surconsommation et où une consommation plus minimaliste devient plus désirable, est de cultiver la qualité et la réparabilité des produits, qui re- trouvent une place prépondérante. Une approche qui va dans le sens de l’essence du luxe (des produits de grande qualité, plus durables et réparables, dont on connaît et dont on valorise l’histoire) – ce pourquoi cette industrie multiplie les initiatives sur le sujet.
« Le luxe, c’est ce qui se répare » affirme d’ailleurs Axel Dumas, président d’Hermès. Certaines maisons proposent ainsi la réparation depuis longtemps, en la facturant ou pas, selon le modèle : c’est par exemple le cas de la marque de chaussures J.M. Weston, installée dans le Limousin depuis 1891 dont tous les modèles sont fabriqués artisanalement et cousus main, puis vendus entre 150 et 3 000 euros. Les peaux viennent d’Allemagne et d’Autriche, car les bêtes françaises n’ont plus la peau assez épaisse depuis que le productivisme a
sélectionné les races et contraint à un abattage rapide. Le tannage se fait à base de tanins végétaux (l’un provient du quebracho, un arbre argentin, et l’autre du châtaignier) dans lequel les peaux de vache sont trempées alternativement pendant deux mois – une opération slow qui pourrait être réduite de plusieurs semaines par les procédés modernes utilisant agents chimiques et fours, sauf que ces derniers n’offrent pas la même qualité, en particulier de résistance à l’eau (les instruments utilisés pour ce processus sont d’ailleurs à peu de choses près identiques à ceux utilisés en 1860, date de création de la tannerie). Les peaux reposent ensuite dans des fosses pendant huit à neuf mois, au milieu des écorces de chêne, pour fixer le tanin. Sur les 100 000 paires de chaussures vendues chaque année par J.M. Weston, toutes les opérations ou presque sont effectuées à la main sur des machines qui ne sont plus produites à grande échelle ce qui contraint la marque à faire appel à des sociétés anglaises qui répliquent pièce par pièce son outillage. Après autant d’attention accordée au « beau travail » et au temps lent en amont (il faut plus d’un an pour passer de la tannerie au mocassin final), J.M. Weston s’engage logiquement à proposer la réparation (en la facturant) : ainsi les clients attachés à leur paire peuvent la garder à vie puisque J.M. Weston assure depuis des années quelque 10 000 réparations par an – et la marque a lancé aussi Weston Vintage en 2020, un service de rachat de leurs anciennes paires iconiques à ses clients, les chaussures subissant ensuite un lifting au sein des ateliers de restauration de la manufacture située à Limoges avant d’être remises en vente avec l’étiquette « seconde main » dans les boutiques de la marque.
Un autre très bon exemple, par sa cohérence au fil du temps, est celui de Patagonia, marque californienne leader de vêtements outdoor plutôt qualitatifs et durables. À l’encontre de la fast-fashion, et dans la lignée de la garantie à vie que la marque propose depuis des années (son centre de réparation nord-américain situé dans le Nevada figure d’ailleurs parmi les plus importants avec près de 45 personnes à plein temps), Patagonia a d’abord mis en place en 2011 un partenariat avec eBay qui permet à ses clients se connectant sur son site d’avoir le choix entre des vêtements Patagonia neufs et des vêtements d’occasion proposés par ses clients – une façon originale de réaffirmer la qualité de ses vêtements et de la faire découvrir à un public nouveau qui hésiterait à mettre le prix. Puis dans la foulée, elle fait paraître en pleine Fashion Week dans le New-York Times une campagne de publicité un rien provocatrice qui montre une polaire Patagonia avec ce slogan original : « N’achetez pas cette veste » ! Et de dresser la liste des impacts écologiques liés à la production de la veste qui apparaît sur l’encart : 135 litres d’eau (« assez pour satisfaire les besoins quotidiens de 45 personnes » précise Patagonia) et neuf kilos de CO2. Message-clef de la marque, qui ne tourne pas autour du pot : n’achetez pas cette veste… si vous n’en avez pas besoin. L’année suivante, en 2012, Patagonia enfonce le clou avec une autre annonce publiée au moment de la Fashion Week et célébrant, sous le slogan « Better used than new », le fait de ne pas changer ses vêtements au fil des modes mais au contraire de les conserver, de les réparer et de vivre avec eux les événements-clefs de son existence ! Le résultat est surpre- nant : alors que les observateurs met- taient en évidence le risque pris par la marque sur un marché qui vit du renou- vellement permanent des collections, Patagonia a touché juste et grâce à cette campagne a augmenté ses ventes de 40% dans les deux années qui ont suivi. Encouragée par ces premiers résultats, Patagonia a lancé dans la foulée une campagne internationale sous le slogan « Repair is a radical act » pour inciter ses clients à réparer (plutôt que de changer) leurs vêtements, mettant en ligne sur le site iFixIt toute une série de « tutoriels » DIY pour réparer soi-même ses vête- ments, transformant une partie de ses boutiques en ateliers de réparation et or- ganisant dans plusieurs pays un Worn Wear Tour à la rencontre de ses clients pour réparer gratuitement les vêtements usagés… même ceux d’autres marques ! Après trois ans de campagnes Worn Wear, Patagonia est allée au bout du chemin en annonçant la généralisation des ventes de vêtements d’occasion à sa marque dans ses boutiques et a ou- vert un site de vente en ligne dédié wornwear.com.
Avec une accélération due à la montée des sujets autour de l’obsolescence programmée ou de la fast-fashion et l’entrée en vigueur de la loi AGEC fin 202223, de nombreuses maisons de luxe et marques de mode proposent désormais ce type de services de réparation, avec des applications et modalités variables : Bottega Veneta ou Chanel proposent ainsi des garanties à vie sur certains produits iconiques, souvent gratuitement (c’est le cas de Bottega Veneta qui a lancé ce ser- vice fin 2022) ; Mulberry propose désormais, comme J.M. Weston, des services de réparation sur tous ses produits, effectués directement en magasins ou dans son usine de fabrication du Somerset, qui répare 10 000 sacs par an ; du côté des marques engagées (et certifiées B Corp), Veja a ouvert des « cordonneries » qui réparent les baskets de sa marque mais pas seulement, sous le slo- gan « les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà » ; tandis que Picture Organic Clothing a lancé une « garantie de réparabilité à vie » depuis l’automne 2020 (qui fonctionne aussi sur les anciennes collections)…
Levier #5 Investir des moyens marketing conséquents pour soutenir ces mutations
Il n’est pas suffisant de changer son offre : encore faut-il faut que cela se sache… et idéalement que les moyens soient mobilisés pour que cela marche commercialement. Alors que la peur du greenwashing fait basculer certaines marques dans la tendance inverse qu’on appelle désormais le greenhushing (le fait de ne pas parler de ses pratiques écologiques ou climatiques et de ne pas promouvoir activement auprès de ses clients ses produits plus responsables), une grande majorité de Français (85% selon le baromètre Greenflex 2023) disent avoir besoin de preuves pour croire aux engagements des marques, tandis que 68% disent que « c’est fatigant de devoir chercher ce qui est responsable et ce qui ne l’est pas afin de faire les bons choix » et que 69% pensent même que la publicité devrait être réservée en priorité aux produits plus respectueux de l’environnement et de la santé.
La publicité n’est d’ailleurs pas forcément le meilleur levier marketing pour promouvoir son offre climatique ou écologique, tant il est vrai que l’impératif de faire court et impactant (qu’il s’agisse d’affichage ou de télévision) incite peu à la nuance et risque de favoriser les raccourcis malheureux (voir l’encadré sur le greenwashing). Comme le dit Florian Palluel, Sustainability & Transparency Manager chez Picture Organic Clothing, « il y a très peu de marketing transparent et honnête, car le temps d’attention sur les réseaux sociaux est limité. Donc la tendance est d’aller sur les sujets faciles, compréhensibles et punchy, comme le pack réutilisable ou les produits faits à partir de bouteilles recyclées – ce sont certes des améliorations sur le produit fini mais ça ne dit rien du modèle économique et pour ce qui nous concerne nous préférons nous concentrer sur la sobriété ou sur l’énergie bas carbone. Les campagnes punchy où les marques montrent leurs incohérences et leurs limites, cela n’existe pas beaucoup ! Ce qui veut dire que pour parler du climat, il faut sûrement limiter la publicité et miser sur un engagement authentique, sur le bouche-à-oreille et une croissance organique. » Ce que confirme Thomas Kolster (voir encadré page suivante) : « tout au long de la chaîne des activités marketing, il y a des possibilités pour l’action climatique. Evidemment, cela commence avec des produits innovants qui ont une valeur ajoutée sur le climat et la biodiversité. Mais ensuite il y a tout ce qu’on peut faire pour en faire découvrir l’histoire, comme les visites de fermes… Et aussi ce qu’on peut faire en magasin, pour mettre en scène l’engagement climatique du produit ou de la marque. La clef à mon sens étant de rendre les gens acteurs, de leur proposer une expérience. Le changement est dans leurs mains : il faut que les produits vendus aident les clients à changer, et à en savoir plus sur le climat… ».
Pour aller dans ce sens, l’étude déjà mentionnée du Réseau Action Climat a montré qu’il ne suffit pas à la grande distribution de mettre les produits responsables en rayons – s’ils ne sont pas ensuite soutenus et valorisés auprès des clients par une large panoplie de moyens marketing : l’information, la mise en avant dans les magasins, les offres promotionnelles, un soutien via les points de fidélisation, etc. Et lors du lancement du Forfait Source de Bouygues Telecom (voir page 58) , l’association de consommateurs Que Choisir n’a pas manqué tout autant de saluer le lancement de ce forfait sobre, « responsable et solidaire » (qui incite les abonnés à limiter leur consommation de data en convertissant les gigas non consommés en dons) que de regretter « que l’opérateur ait choisi de ne pas en faire la promotion 24 ». Car Bouygues n’a pas vraiment prévu de faire la promotion de son innovation climatique, si ce n’est par un système de par- rainage entre utilisateurs : « le forfait n’est pas accessible en boutique et il n’apparaît pas sur le site de l’opérateur – il faut, pour y souscrire, se rendre sur une page web dédiée. 25 » Une remarque qui milite aussi pour l’intégration aux sites web marchands d’options bien visibles incitant les clients à faire un tri responsable entre les offres proposées, plutôt que de « cacher » les offres climatiques ou écologiques dans des catalogues foisonnants : à titre d’exemple, le site de courses en ligne de Carrefour propose, dans sa version la plus récente, des filtres visibles pour les produits « bio et écologiques », pour les labels de qualité (dont, à nouveau, le bio mais aussi l’écolabel, l’origine France, les AOP ou AOC, etc.), pour les régimes alimentaires (dont le régime végétarien), pour la note Nutriscore ou Ecoscore, et enfin pour l’absence de substances controversées. Un chan-
gement notable, même si ces options restent peu ou pas présentes sur la page d’accueil du site, où abondent les promotions et incitations commerciales traditionnelles… À noter, toujours sur le e-shopping, certaines marques comme Nike ou Amazon proposent depuis ces dernières années une option de livraison no rush (sans urgence), souvent gratuite, qui donne à l’entreprise le temps d’expédier le colis de manière efficace et de réduire le nombre de camions sur la route. Autant d’incitations qui, dans le parcours du client, constituent autant de signes ou de preuves de l’engagement climatique de la marque.
Un autre levier marketing pour inciter les clients à choisir l’offre verte, tant que celle-ci n’est pas « par défaut » (c’est-à- dire la seule qui soit proposée, peut consister, pour les marques et les enseignes, à proposer un prix incitatif qui reflète, d’une certaine façon, le moindre coût pour la planète (voir l’exemple de Monoprix qui en 2016 a décidé de ne plus vendre que des baguettes bio, mais toujours au même prix unitaire de 0,85 euro). Pour mémoire à ce sujet, une étude 26 récente estime le coût caché de notre alimentation (via les dommages causés aux écosystèmes par la production alimen- taire… mais aussi à la santé humaine) au double de ce que dépense le consommateur : pour chaque dollar dépensé par les consommateurs, les chercheurs estiment qu’il est nécessaire d’ajouter quasiment deux dollars pour obtenir le coût total ou « réel » de l’alimentation mondiale. Pour Romain Espinosa, économiste au CNRS, « ces coûts sont cachés car ils ne sont pas reflétés dans le prix payé par le consom- mateur et le producteur n’indemnise pas la société pour ce dommage ».
La complexité pour les marques vient du fait que le prix demandé au consommateur est en réalité fixé par le distributeur – celui-ci est libre de proposer un produit à prix coûtant ou d’ajouter une marge qui augmente très significativement le prix initialement fixé par l’industriel. C’est vrai également pour des produits non alimentaires : il est par exemple fréquent, en grande surface, que l’écorecharge d’une marque de lessive connue soit vendue jusqu’à 25% plus cher que le bidon correspondant (qui reste le produit d’appel), au mépris du principe économique qui voudrait que le prix soit une information donnée au client sur le coût global (et en l’occurrence ici environnemental) d’un produit et une incitation à faire le bon choix. Les stratégies commerciales des marques et enseignes expliquent souvent ce décalage : ainsi, en 2017, une étude de l’UFC-Que Choisir a montré que si remplir son panier de fruits et de lé- gumes biologiques coûtait alors 79% plus cher qu’avec des produits conventionnels, 46% de ce surcoût était dû à des « sur- marges » de la grande distribution visant à profiter d’un marché de niche – la moitié restante étant liée à la spécificité de l’agriculture biologique, dont les rendements sont moindres et le besoin de main- d’oeuvre plus important.
Les investissements et leviers marketing devraient donc, à l’encontre de ce qui se passait historiquement, être orientés prioritairement vers les produits vertueux, de manière à en développer la notoriété et l’attractivité, tout en contribuant à en faire la nouvelle « norme sociale ». De ce point de vue, une règle de bon sens à retenir est celle d’une proportionnalité (voir l’interview de Jean-Fran-çois Julliard, DG de Greenpeace) qui reste à calibrer par la marque mais qui pourrait utilement renforcer le reporting des entreprises – ainsi la part des investissements marketing ou publicitaires consacrée aux produits responsables pourrait être équivalente (ou légèrement supérieure, afin d’en faciliter l’émergence commerciale) à la part du chiffre d’affaires actuel ou visé, à la part des in- vestissements en R&D qui leur est consacrée, etc.
Levier #6 Accompagner le développement de nouveaux modèles d’affaires à impact, en embarquant l’amont et l’aval
Au-delà de l’innovation et de la conception de produits ou services plus responsables puis de la transformation globale de l’offre pour que ces produits ou services deviennent « l’option par défaut », l’étape ultime de transformation pour une entreprise est celle de son modèle d’af- faires, qu’il s’agit de réinventer à partir de l’urgence climatique et des limites plané- taires. L’objectif est ainsi de ne plus être en situation de devoir en continu pallier l’augmentation des impacts environne- mentaux (négatifs) qu’engendrent des ventes en croissance, mais au contraire d’aligner les impératifs – de manière à faire en sorte que le développement de la marque aille de pair avec un impact positif sur le climat, au niveau d’un territoire, d’un marché, etc. Dans cette perspective, l’entreprise inscrit au cœur de la valeur qu’elle propose une contribution à la « neutralité carbone » et ses produits ou services deviennent des leviers de réduc- tion des émissions chez ses clients – elle peut alors intégrer à ses indicateurs clefs les émissions évitées par l’usage de ses produits ou services vendus. Les dirigeants sont conscients de l’ampleur du défi que cela représente : selon une étude Mazars, 53% d’entre eux considèrent qu’ils devront adapter en profondeur leur business model pour atteindre la neutralité carbone.
Fondamentalement, ce travail sur le modèle d’affaires consiste à repenser dans le détail la façon dont se crée et se répar- tit la valeur de l’amont à l’aval 27 – en veillant à chaque étape à intégrer l’impératif climatique, notamment. En pratique cela revient à explorer et à travailler finement sa proposition de valeur et la façon dont elle se construit tout au long de sa supply chain, en déconstruisant son produit ou service pour le reconstruire avec les alternatives les plus responsables. La supply chain est en effet une dimension clef de cette « bascule » vers des modèles éco- nomiques à impact : dans de nombreux modèles d’affaires, on l’a dit, les fournisseurs sont au cœur de la construction (et de la répartition) de la valeur ; c’est aussi le lieu où les principaux impacts climatiques, environnementaux et sociaux se produisent (les 3⁄4 de l’empreinte climatique pour les produits textiles ou agro-alimentaires, par exemple). Autrement dit, pour être crédibles à terme sur le sujet climatique, les entreprises vont de plus en plus devoir aller challenger leurs achats et leurs fournisseurs, en demandant des garanties de réduction qu’elles seront capables ensuite de mettre en indicateurs (via l’analyse de cycle de vie ou le bilan carbone des produits) et de raconter aux clients, de manière à rendre plus attractifs les produits plus vertueux : meilleure traçabilité du sourcing, matières plus vertueuses, process industriels moins carbonés et plus innovants, réduction des déchets et circularité, énergie renouvelable, etc. Comme l’affirme Veja, « la transparence est l’avenir de l’environnementalisme ». Et c’est bien ce sur quoi la marque fonde son succès depuis 2004 (voir page 32) : elle a construit un modèle économique 100% transparent et à rebrousse-poil du modèle dominant sur le marché de la basket, où l’essentiel de la valeur vendue du client (soit 70% du prix) est fondé sur le marketing et la communication. En ne faisant pas de publicité ou de promotions avec des égéries, Veja a limité les coûts associés à ces activités et mobilisé ses ressources pour bâtir avec ses fournisseurs une autre approche, plus équitable et écologique, qui est largement détaillée, chiffres à l’appui, sur son site.
Pour engager cette transition du modèle d’affaires de l’entreprise vers l’impact et transformer la façon dont l’entreprise crée de la valeur (financière mais aussi environ- nementale/sociétale) tout au long de ses activités, la marque est un « tigre dans le moteur » qui est capable de mobiliser une énergie considérable :
D’abord parce qu’elle est le visage de l’entreprise aux yeux des consommateurs et qu’elle met en jeu sa réputation publiquement (quand on s’engage, on s’expose – et inversement) ; Ensuite parce qu’elle pilote l’innovation et la rénovation des produits et services, l’évolution du portefeuille d’offres, parce qu’elle a la latitude de décider sur quelle partie de son offre elle déploie les moyens marketing les plus importants (publicité, promotion, etc.) afin de la booster et de faire pragmatiquement pivoter l’origine de son chiffre d’affaires – voir la façon dont Philips, notamment, fait évoluer la part de ses ventes provenant de produits mieux-disants ou éco-labellisés, en commençant par un outil de scoring environ- nemental des produits en six critères développé en 2012, puis par un « auto-label » interne (décerné si le produit améliorait d’au moins 10% sur au moins un critère la performance, non pas du meilleur produit chez Philips mais du meilleur produit sur le marché) déployé sur 100% des innovations… ce qui a per- mis d’atteindre 70% du chiffre d’affaires du groupe en 2020 ;
Egalement parce que les consommateurs entretiennent une relation émotionnelle avec les marques qu’ils affectionnent, et que l’émotion est (littéralement) ce qui met en mouvement – or la mobilisation des consommateurs est souvent nécessaire pour accompagner le changement de modèles d’affaires qui peut être aussi un changement dans les modes de consommation : passage de l’achat à la location, de la possession à la mutualisation, du produit au service, etc..
Parce que si la marque choisit de collaborer avec des fournisseurs plus vertueux (ou de les inciter à adopter des pratiques plus vertueuses en leur fournissant les ressources nécessaires ou en instaurant des critères écologiques dans ses cahiers des charges), elle est aussi la mieux placée pour « mettre en récit » et valoriser en- suite ces pratiques en les rendant visibles pour les clients de manière transparente, conformément à la logique nouvelle de la « production ostentatoire » où les condi- tions de fabrication sont ce qui donne sa valeur au produit. Après tout, le rôle du marketing est bien de mettre en résonance la réalité du produit avec des tendances sociétales, autrement dit avec ce qui préoccupe ou intéresse les consom- mateurs, de manière à obtenir leur préférence. De ce point de vue, tous les efforts faits par les marques pour mettre en scène ces dernières années la traçabilité de leurs produits voire de leurs matières premières (de Fleury-Michon à Nike, en passant par McDonald’s et beaucoup d’autres – avec des cartes interactives, un suivi par la blockchain ou simplement des visites organisées chez les fournisseurs) sont particulièrement intéressants car ils contribuent à soutenir l’idée que le marketing ne consiste pas tant à construire une histoire fictive de la marque (comme dans la publicité) qu’à raconter l’histoire vraie des produits ;
Parce que la marque est la seule capable, par exemple, de transformer (par le récit) en avantage concurrentiel une déci- sion en apparence contraire au business, comme un renoncement dans son offre ou le fait d’amener ses clients à limiter leur consommation – en générant par son en- gagement un surcroît d’attractivité (voir le cas Telmont page 30, mais aussi la façon dont Leclerc a historiquement valorisé en communication son choix de ne plus pro- poser de sacs plastique gratuits à ses clients, exprimant fortement ses valeurs et sa différence). Ici la marque peut aller jusqu’à se doter d’indicateurs un peu au- dacieux liés à la hausse en proportion des ventes des produits les plus responsables, combinée à la baisse en absolu du vo- lume d’affaires provenant des produits les plus carbonés ;
Pour conclure, la marque est aussi, par définition, une communauté vivante d’actionnaires, de consommateurs, de fournisseurs et de parties prenantes partageant plus que des produits : un même projet et un même « récit » – et cette communauté peut constituer une « minorité active », une alliance détermi- née capable d’agir comme un levier de changement sociétal et d’amplifier l’impact de la marque (voir le cas BrewDog page 48, mais aussi l’initative Patagonia Action Works par laquelle la marque d’out- door engagée connecte sa communauté de clients à des ONG environnementales pour trouver des événements, faire des dons ou se porter volontaire dans des ac- tions pour la planète).
Levier #7 Mettre le climat au cœur de sa raison d’être
L’approche est un peu audacieuse et ciblée, mais le défi de la crise climatique est tellement immense et interdépen- dant d’autres sujets (de la biodiversité aux migrations, en passant par la justice environnementale) que cela peut faire du sens, pour une marque, que d’aller au bout de la démarche en plaçant car- rément la lutte pour sauver le climat au cœur de son purpose. Autant dire qu’en écho à Oscar Wilde, c’est sans doute faire preuve de sagesse que de fonder sa raison d’être sur un tel enjeu sociétal et planétaire suffisamment grand qu’on est sûr de ne pas le perdre de vue lors- qu’on le poursuit.
C’est ainsi qu’Interface, leader mondial des dalles de moquette et de l’écologie industrielle déjà évoqué, a élaboré sa nouvelle mission Climate take-back exclusivement focalisée sur la « réparation » du climat et sa volonté de devenir « carbon-négative » en 2040. Il faut dire que dans le cadre de sa précédente Mission Zero (élaborée en 1996 à l’horizon 2020), Interface a déjà réduit de 96% ses émissions de GES par unité produite, de 76% l’empreinte carbone de ses dalles tout au long de leur cycle de vie, en faisant passer l’énergie consom- mée par ses sites à 75% d’origine renouvelable. Pour aller plus loin, la marque ambitionne désormais d’inver- ser la tendance du changement climatique en concentrant ses efforts sur quatre axes : mener toutes ses activités de manière à avoir zéro impact sur l’en- vironnement ; faire du carbone une res- source et non un ennemi (par exemple en fabriquant des produits qui séquestrent efficacement le carbone) ; soutenir active- ment la capacité des écosystèmes à régu- ler le climat ; et faire acte de leadership une nouvelle fois en menant une révolution qui transforme l’industrie en une force de changement planétaire…
Même ambition chez Picture Organic Clothing, marque déjà citée, qui a dès sa création à Clermont-Ferrand en 2008 mis au cœur de sa mission la volonté de lutter contre le changement climatique à travers toutes ses actions. Ou celle du géant suédois Max Burgers, devenu depuis 2018 la première enseigne de restauration à assurer la contribution de ses activités et de ses produits à la neutralité planétaire, en allant comme déjà évoqué jusqu’à modifier très significativement son offre pour la rendre à 50% végétarienne. Enfin, Paris La Défense s’est engagé dans sa nouvelle raison d’être rendue publique fin 2021 à devenir le premier quartier d’affaires post-carbone au monde, avec des engagements ambitieux sur les exigences environnementales renforcées pour les futures constructions, sur la rénovation des tours actuelles, sur la mobilité douce et sur la végétalisation des espaces…
Conclusion
Dans un contexte où face à l’urgence climatique, les entreprises sont sommées de s’engager sur la voie de la post-croissance ou d’une croissance plus soutenable, la question de la trans- formation radicale de l’offre et du modèle d’affaires est inévitable. Mais le chemin est escarpé pour les marques, entre les pressions croissantes pour qu’elles intègrent à leur stratégie les grands enjeux de notre époque (en tête desquels le changement climatique mais sans négliger les autres : la biodiversité, l’impact territorial, l’inclusion sociale, …) et les risques de climate-washing que les parties prenantes sont promptes à pointer du doigt. Pour dépasser cette complexité, les marques se lancent bien souvent en quête d’une Big Idea ou d’une innovation rupturiste – qui ont en commun d’aboutir à des expérimentations certes médiatiques mais plus rarement à un véritable modèle capable de bousculer les règles d’un marché et surtout de lier clairement la création de revenus et l’impact climatique positif. Pourtant, l’analyse des exemples de marques qui ont réussi à transformer leur offre, à développer ces modèles d’affaires vertueux et à poser les bases d’un nouvel entrepreneuriat climatique montre qu’elles excellent surtout dans ce que le biologiste Stuart Kauffman ap- pelle les « possibilités adjacentes » : un cheminement progressif qui se fait en saisissant les opportunités à portée de main, moins spectaculaire mais plus efficace que le grand bouleversement que certains appellent, parfois en vain, de leurs vœux face aux défis de la transition écologique. Dans ces conditions, l’agilité dans l’exploration de cette « carte des possibilités»devientunatoutclefpour les marques qui veulent faire converger impact et création de valeur.
Avant de se lancer tête baissée dans le développement de nouveaux services de location ou de seconde main, gare à la fausse bonne idée ou à l’écran de fumée : souvent encore, les modèles immatériels (fonctionnalité, location, seconde main, réparation, abonnement…) représentent une part très limitée de l’activité, tout juste auto-financée (c’est le cas par exemple des activités de réparation ou de reprise/revente de vêtements de seconde main – et ce n’est pas la moindre qualité de Décathlon que d’avoir historiquement persévéré dans l’organisation du Trocath- lonbi-annuel, à une époque où la circularité n’était pas à la mode, et où l’initiative était tout juste à l’équilibre), même s’ils sont largement présentés en communication. Ils ne doivent donc pas masquer la « matérialité » des enjeux – car l’essentiel des émissions de GES reste lié aux matières premières utilisées, au poids carbone intrinsèque du produit considéré (emballage et usage compris) et aux déchets générés en amont ou en aval, qui doivent être travaillés de manière priori- taire. Par ailleurs, comme souvent, le diable est dans les détails car le plus souvent l’impact réel dépend des conditions de mise en œuvre (par exemple le mode de transport du produit entre deux clients pour la location d’une tondeuse à gazon) et de la capacité de la marque à combiner les approches (par exemple location, cir- cularité et production locale). En sachant, par exemple, que le leasing n’est pas toujours la solution la plus écologique… ni la plus économique pour le client 28, que la vente de vêtements de seconde main n’évite pas la fast-fashion et incite parfois à la surconsommation en tablant sur le Black Friday, tandis que la location avec abonnement incite les clients à profiter des dernières nouveautés et à renouveler leurs produits sans toujours en prendre soin…
Dans tous les cas, partir du produit, pour le décomposer avant de reconstruire chaque étape de la chaîne de valeur pour en optimiser l’impact sur le climat et l’environnement, sans oublier la justice économique et le développement social, reste une excellente option. En s’armant de courage aussi, pour se lancer dans les éventuels renoncements qui se présenteraient en chemin.
Avec l’urgence climatique, nous sommes confrontés à la difficulté de faire évoluer la société, les consciences collectives et les comportements – mais nous n’arrivons pas à nous projeter dans une vision du futur alternative et désirable. Si les mouvements écologistes et les activistes ont passé beaucoup de temps à pointer du doigt ce qui ne va pas et doit être changé, ils ont souvent échoué à proposer un récit positif capable de mettre en mouvement ceux auxquels ils s’adressent. C’est pourquoi, ces derniers temps, dans la lignée de ce qu’a développé Yuval Noah Harari dans Sapiens (il y explique notamment que ce qui distingue l’Homme des autres animaux et lui permet d’accomplir de grandes choses, c’est sa capacité à se raconter des his- toires sur ce qui n’existe pas encore, qu’il s’agisse d’aller sur la Lune ou de créer une entreprise), le monde écologiste mais aussi artistique est très mobilisé autour de cette idée que pour mobiliser plus largement tous les publics et accélérer la transformation de notre monde (et de nos modes de vie) vers le développement durable, nous devons d’abord transformer les imaginaires du futur. Car muscler notre capacité à imaginer des scénarios alternatifs positifs active aussi
notre capacité à les réaliser, et nous aide à dépasser la sidération que provoque l’accumulation des menaces, notamment sur le climat. Dans cette perspective, le réalisateur et activiste Cyril Dion (qui avait interviewé sur le sujet Nancy Huston dans son film « Demain »), a lancé avec Magali Payen et Marion Cotillard en 2022 la société de production Newtopia, autour de l’idée que pour créer un nouveau monde, il faut commencer par l’imaginer avec des films, des séries, des histoires… qui proposent une interprétation de la réalité, et donnent sens à des faits. Après tout, insiste-t-il, quand on partage un récit de manière forte, les gens l’adoptent et suivent les mêmes règles du jeu, qui se traduisent ensuite dans des structures économiques, politiques, etc. Et de donner l’exemple de la façon dont Hollywood, après la seconde Guerre Mondiale, a négocié avec le Plan Marshall des droits de diffusion sur les écrans européens pour répandre sa vision de la consommation et du bonheur par les biens matériels, dans l’idée de lutter contre le communisme. Pour Cyril Dion « c’est là qu’est l’essentiel de nos difficultés : si l’on ne s’attaque pas au récit dominant qui sous-tend la société de consommation, on se cantonne à des ajustements, comme la collecte ou le recyclage qui ne marchent pas et l’on s’épuise à vouloir changer le cours de l’Histoire… »
Dans le travail à faire autour de ces nouveaux récits alternatifs, et du changement des normes sociales, plusieurs acteurs ont un rôle à jouer : les artistes (agissant comme des mediums qui se laissent tra- verser par les courants de l’époque et restituent cela sous forme d’œuvres d’art qui sont capables de nous émouvoir… et donc de nous mouvoir) mais aussi les médias (car on ne peut construire un récit collectif que sur des éléments factuels, issus du réel, qu’on organise dans une direction commune)… et enfin les marques.
Conseils issus de l’étude « POUR UN ENGAGEMENT CLIMATIQUE DES MARQUES » d’Utopies paru en avril 2024.